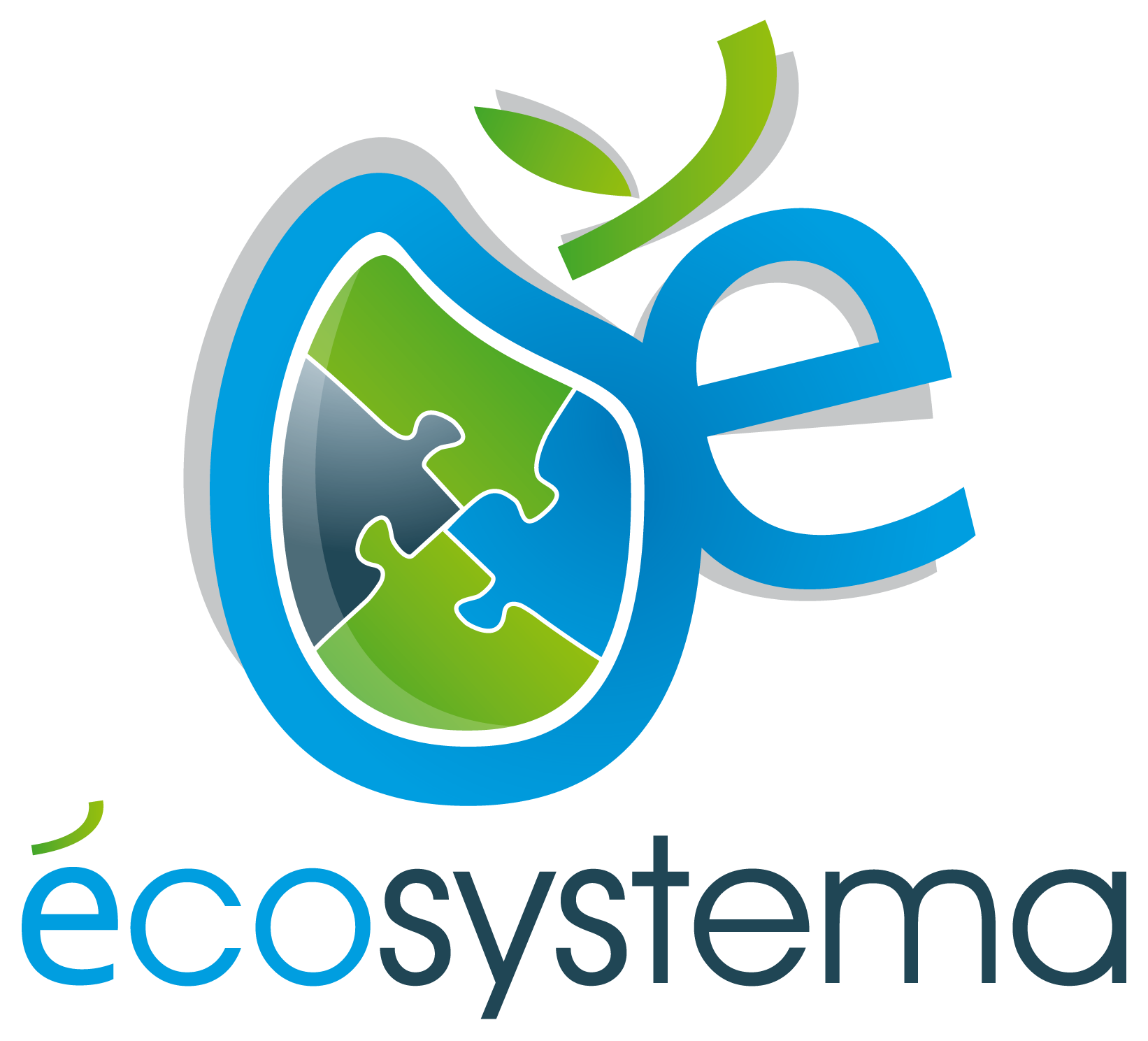Introduction
Les syrphidae sont une famille de Diptera (vern. = mouches) fascinantes et écologiquement très importantes. Leur diversité d’apparences (= habitus), leurs cycles de vie (= phénologie) variés et leurs rôles clés dans la pollinisation et la lutte biologique, en font un groupe d’insectes digne d’intérêt et d’étude scientifique et agronomique. Leur présence est généralement un signe de bonne « santé » écologique (se référer au concept de « Biodiversité » traité dans l’article précédent de l’auteur).
Attention, le terme vernaculaire de « Syrphes » et impropre et prête à confusion ; en effet, il correspond à deux familles distinctes : les Diptera Microdontidae et Syrphidae. On lui prêtera donc plus commodément le nom scientifique de Syrphidae dans le présent texte.
Présentation des Diptera
Les Diptera sont un ordre d’insectes communément appelés mouches. Ils sont caractérisés par le fait de ne posséder qu’une seule paire d’ailes membraneuses fonctionnelles, la seconde paire étant réduite à de petits organes en forme de massues (appelés haltères), qui leur servent d’organes d’équilibre.
Voici quelques caractéristiques importantes des Diptères :
- Une seule paire d’ailes : c’est la caractéristique la plus distinctive de cet ordre.
- Haltères : La seconde paire d’ailes est modifiée en haltères, essentiels pour la stabilisation en vol.
- Diversité : C’est l’un des ordres d’insectes les plus cruciaux en termes de nombre d’espèces, avec plus de 150 000 espèces décrites et largement bien plus de taxons non découverts.
- Distribution mondiale : on les trouve dans presque tous les habitats terrestres et aquatiques.
- Rôles écologiques variés : les diptères jouent de nombreux rôles écologiques, notamment la pollinisation, la décomposition de la matière organique, la prédation et le parasitisme.
L’ordre des Diptères est divisé en plusieurs sous-ordres, dont les deux principaux sont les Nematocera et les Brachycera.
Les sous-ordres de Nematocera et Brachycera
Voici un résumé de leurs caractéristiques distinctives :
Nematocera (vern. = Nématocères) :
- Antennes longues, composées de nombreux segments similaires (souvent plus de 6), généralement filiformes ou plumeuses,
- Palpes maxillaires longs, souvent composés de 4 à 5 segments,
- Thorax généralement plus allongé,
- Larves souvent aquatiques ou vivants dans des milieux humides, avec une capsule céphalique bien développée.
- Adultes fréquemment de petite taille et délicats.
Exemples courants : moustiques (Culicidae), tipules (Tipulidae), simulies (Simuliidae), etc.
Brachycera (vern. = Brachycères) :
- Antennes courtes, composées de 3 segments distincts, le dernier étant souvent plus grand et portant un style ou une arista,
- Palpes maxillaires courts, généralement composés de 1 ou 2 segments,
- Thorax généralement plus compact et robuste,
- Larves terrestres ou aquatiques, fréquemment acéphales (c.-à-d. sans capsule céphalique bien développée) ou avec une capsule céphalique réduite,
- Adultes de taille variable, habituellement plus robustes que les Nématocères.
Exemples courants : mouches vraies (Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae, etc.), taons (Tabanidae), asiles (Asilidae), etc. Et enfin surtout les Syrphidae.
Il existe également d’autres sous-ordres. Cependant, la distinction principale entre Nematocera et Brachycera reste fondamentale pour comprendre la diversité de cet ordre d’Insecta, que sont les Syrphidae.
Présentation des Syrphidae
La famille des Syrphidae, communément appelées abusivement « syrphes » ou mouches des fleurs, est un groupe fascinant de Diptera (mouches vraies) appartenant au sous-ordre des Brachycera et à la super-famille des Syrphoidea. Elles se distinguent par plusieurs caractéristiques remarquables :
Caractéristiques Générales des Syrphidae :
- Deux ailes fonctionnelles : comme tous les Diptera, les Syrphidae ne possèdent qu’une seule paire d’ailes membraneuses fonctionnelles pour le vol. La seconde paire d’ailes est réduite à de petits organes sensoriels appelés haltères, qui les aident à maintenir leur équilibre en vol.
- Antennes courtes : conformément à leur appartenance au sous-ordre des Brachycera, les Syrphidae ont des courtes antennes, généralement composées de trois segments distincts, le dernier segment portant souvent une arista (c.-à-d. une soie dorsale) ou un style (une extension terminale). La forme de l’arista (nue, pubescente, plumeuse) est un caractère important pour l’identification des genres et des espèces.
- Apparence variée et habituellement mimétique : l’une des caractéristiques les plus frappantes des Syrphidae est leur capacité à imiter l’apparence d’Hyménoptera tels que les Vespidae (vern. = guêpes), Apoidea et les Bombus spp. Ce mimétisme batésien (voir glossaire) leur offre une protection contre les prédateurs qui évitent les insectes piqueurs. Cette imitation se manifeste par des motifs de couleurs similaires (jaune, noir, orange), des bandes sur l’abdomen et parfois même un comportement de vol rapide et bourdonnant. Cependant, contrairement aux Hymenoptera, les Syrphidae ne possèdent pas de dard et sont totalement inoffensives pour l’homme.
- Yeux composés bien développés : leurs grands yeux composés leur procurent une excellente vision, ce qui est crucial pour la chasse (chez les larves prédatrices) et la recherche de nectar et de partenaires (chez les adultes). Chez certaines espèces (pas toutes !), les yeux des mâles se rejoignent sur le dessus de la tête (holoptiques), tandis que chez les femelles, ils sont séparés (dichoptiques).
- Pièces buccales adaptées à l’alimentation liquide : les adultes possèdent des pièces buccales de type lécheur-suceur, adaptées pour se nourrir de nectar, de pollen et occasionnellement de miellat. Ils ne peuvent pas piquer ni mâcher.
- Taille variable : la taille des Syrphidae varie considérablement selon les espèces, allant de quelques millimètres à plus de deux centimètres de long (référence mondiale ; à nuancer dans le massif armoricain).
Cycle de vie et biologie :
- Métamorphose Complète (Holométabole) : les Syrphidae passent par quatre stades de développement : œuf, larve, pupe et adulte (appelé aussi Endoptérygote, c.-à-d. des Insecta à métamorphose complète avec un stade pupal immobile).
- Larves diversifiées : les larves de Syrphidae présentent une grande diversité de forme et d’habitudes alimentaires. On distingue principalement trois types de larves :
- Larves aphidiphages (prédatrices de pucerons) : elles sont souvent allongées, sans pattes apparentes, et se déplacent en rampant. Elles sont d’une importance capitale en tant qu’agents de lutte biologique contre les pucerons.
- Larves saprophages : elles se nourrissent de matière organique en décomposition, que ce soit dans l’eau stagnante (comme les larves d’Eristalis spp.), dans le bois en décomposition ou dans les nids d’insectes sociaux.
- Larves phytophages : certaines espèces ont des larves qui se nourrissent de tissus végétaux chlorophylliens.
- Pupes variées : la pupe peut être nue ou protégée par la dernière peau larvaire durcie (puparium). La forme et la couleur de la pupe varient également selon les espèces.
- Adultes pollinisateurs et prédateurs : les adultes se nourrissent principalement de nectar et de pollen, contribuant ainsi à la pollinisation de nombreuses plantes, sauvages et cultivées. Certaines espèces adultes peuvent par ailleurs consommer du pollen pour assurer la maturation de leurs œufs.
Rôle écologique :
- Pollinisation : les Syrphidae sont des pollinisateurs importants, visitant une grande variété de plantes à fleurs pour se nourrir de nectar et de pollen. Leur contribution à la pollinisation est souvent sous-estimée par rapport aux Apoidea, mais elle est significative dans de nombreux écosystèmes.
- Lutte biologique : les larves de nombreuses espèces de Syrphidae sont des prédatrices voraces de pucerons ou Aphidiens de l’ordre des Homoptera, de cochenilles de la famille des Coccoidea et d’autres petits insectes ravageurs des plantes. Elles jouent un rôle crucial dans la régulation naturelle des populations de ces ravageurs dans les jardins (Horticulture), les cultures (Agriculture) et les écosystèmes semi-naturels (Écologie de la restauration). C’est pourquoi les Syrphidae sont considérés comme des alliés précieux en agriculture, en jardinage biologique et pour les écologues.
- Indicateurs environnementaux (voir ci-dessous) : la présence et la diversité des populations de Syrphidae peuvent être des indicateurs de la « qualité » de l’environnement, notamment concernant — par exemple — la disponibilité des ressources florales et la présence de ravageurs des cultures.
Les Syrphidae comme indicateurs de l’état de conservation des habitats.
Les Syrphidae (appelés « mouches des fleurs »), sont de plus en plus reconnus comme de précieux indicateurs de l’état de conservation des habitats semi-naturels (« indicateurs environnementaux ») en raison de plusieurs caractéristiques clés.
Les arguments pour lesquels les Syrphidae sont de bons indicateurs sont :
- Une distribution étendue : on les trouve dans une grande variété d’habitats à travers le monde, à l’exception des déserts extrêmes (de sable et de glace), de la toundra (c’est à très haute latitude) et de l’Antarctique.
- Des habitats larvaires et comportement alimentaires diversifiés ; en effet, les larves de Syrphidae présentent une gamme remarquable de niches écologiques (se référer au glossaire sur cette notion essentielle en autoécologie). Elles peuvent être :
- Prédatrices : elles se nourrissent ainsi de pucerons (Hemiptera), de thrips (Thysanoptera) et d’autres insectes à corps mou, ce qui les rend sensibles aux changements dans les dynamiques populations de ravageurs des cultures et à l’utilisation d’insecticides.
- Saprotrophe : elles vivent dans les matières végétales et animales en décomposition, les excréments ou les eaux stagnantes, reflétant la teneur en matières organiques et la qualité de l’eau de leur environnement (= milieu).
- Phytophage : elles se nourrissent des feuilles ou des tiges des plantes à fleurs (Plante Hôte de la Larve ; PHL), ce qui indique l’état de conservation et la diversité des communautés végétales (texture et structure des peuplements végétaux).
- Myrmécophile ou termitophile : vit dans les nids de fourmis (Hymenoptera) ou de termites (Isoptera) ; ces dernières ayant un rôle majeur dans l’équilibre sanitaire des boisements.
- « Inquiline » : Présentes dans les nids des Hymenoptera sociaux comme les Bombus spp. et les Vespidae.
- Une dépendance de l’adulte vis-à-vis des ressources florales : les Syrphidae adultes se nourrissent principalement de nectar (Sucres ; Acides aminés et protéines ; etc.) et de pollen (glucose et fructose + saccharose « formé » en moindre proportion ; protéines ; lipides dont une partie d’acides gras essentiels ; etc.), ce qui les rend dépendants de la disponibilité et de la diversité des plantes à fleurs. Leur présence et leur abondance sont donc liées à la diversité biologique des plantes (la « texture ») et à la structure de l’habitat.
- Une relative facilité pour l’identification ; en effet, comparées à d’autres groupes d’Insecta, de nombreuses espèces de Syrphidae sont visibles et peuvent être identifiées à l’aide des clés taxonomiques modernes disponibles, voire (à nuancer toutefois, car l’usage d’une binoculaire est souvent déterminant) même des « méthodes photographiques ». Dans toutes les configurations et à l’exemple des Odonata, Orthoptera et Lepidoptera, cela facilite la surveillance et la collecte de données (« monitoring » écologique).
- Une remarquable sensibilité aux changements des facteurs écologiques ; ainsi, la diversité de leurs cycles de vie et de leurs exigences en matière d’habitat signifie que les différentes espèces réagissent à divers facteurs de stress environnementaux, tels que :
- la perte d’habitat,
- la fragmentation,
- la pollution,
- et le changement climatique (« Global change »).
- De bons indicateurs de la diversité des paysages ; la présence d’une grande diversité d’espèces de Syrphidae indique (en écologie du paysage) fréquemment un paysage hétérogène avec une variété d’habitats et de ressources alimentaires. À contrario et comme résultante, une réduction de la diversité du paysage peut avoir un impact négatif sur les peuplements (Communautés d’espèces) de Syrphidae.
Par l’approche de la dynamique des populations de Syrphidae, nous pouvons caractériser :
- Le potentiel d’analyse des traits fonctionnels : l’analyse des « traits fonctionnels » (anglicisme n’étant pas retenu par tous les écologues – en Écologie fonctionnelle — francophones. Voir glossaire) des communautés de Syrphidae (par exemple, les habitudes alimentaires des larves, les préférences florales des adultes) peut fournir des informations plus approfondies sur les processus de l’écosystème et l’impact des changements environnementaux (entre autres, le changement global du climat ou « global change ».
- Les méthodes spécifiques d’utilisation des Syrphidae en tant qu’indicateurs environnementaux (ou écologiques) :
- Richesse et abondance des espèces : les changements dans le nombre d’espèces de Syrphidae et dans la taille de leurs populations peuvent refléter la qualité de l’habitat et le stress environnemental. (Une plus grande diversité est souvent liée à des écosystèmes plus « sains »).
- Espèces indicatrices : certaines espèces de Syrphidae sont étroitement associées à des types d’habitats ou à des conditions environnementales spécifiques et peuvent être utilisées pour indiquer la présence et la qualité de ces environnements (par exemple, « la santé » des forêts, les conditions de l’état de conservation des zones humides).
- Groupes fonctionnels : l’abondance relative des différentes guildes d’alimentation des larves (prédatrices, saprotrophes, phytophages) peut indiquer des changements dans les fonctions de l’écosystème, telles que le cycle des nutriments ou la lutte contre les parasites.
Ainsi, la méthode spécifique « Syrph the Net » (StN) (voir annexe) a été développée. Il s’agit d’un « système expert » développé pour standardiser l’utilisation des Syrphidae comme indicateur écologique (ou « bio-indicateurs ») pour évaluer l’état de conservation des habitats semi-naturels.
Conclusion
Nous pouvons conclure, sur cet aspect fondamental et remarquable de cette famille de Diptera, que les Syrphidae constituent un outil précieux pour l’évaluation (Études d’impact, plans de gestion, évaluation des PdG, etc.) et surveillance (Suivis écologiques SE) de l’environnement en raison de leur diversité écologique, de leur sensibilité aux changements environnementaux et de leur relative facilité d’identification. Ils peuvent donc fournir des informations sur l’état de conservation des habitats (approche d’écologie de la restauration), la diversité des paysages (approche d’écologie du paysage), les niveaux de pollution (veille en écotoxicologie) et l’impact des pratiques de gestion agronomique.
Glossaire
Auteur : Gabriel J. LE BRAS (GLB) - sources bibliographiques personnelles référencées.Biocénose : c’est un groupement d’être vivant dont la composition, le nombre des espèces et celui des individus reflète certaines conditions moyennes du milieu ; ces êtres sont liés par une dépendance réciproque. Par là, elle innove dans la description des communautés biotiques. Elles représentent, dans la série des niveaux d’organisation qui caractérisent le monde vivant, des unités structurées à l’échelle des populations, puisqu’elles regroupent des ensembles d’individus habitant à une époque donnée dans un milieu donné. Dans un tel système, deux faits essentiels caractérisent l’agencement des espèces : la distribution spatiale (ordonnance caractéristique) et temporelle (obéissant à une séquence de stades ou phénophases). (d’après 331)
Biotique (facteur) : se dit de l’intervention de certains êtres vivant sur l’écologie ou l’évolution d’une biocénose : pacage, parasitisme, transport de semences, ombrage forestier… ; quand cette action est due à l’homme, il s’agit de facteurs anthropique ou anthropozoogène 942.
Biotope : aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions écologiques particulières (sol, climats, etc.) servant de support physique aux organismes qui constituent la biocénose 263. N.B. : l’écosystème est constitué par l’ensemble. biotope + biocénose 942.
Biocénose : c’est un groupement d’être vivant dont la composition, le nombre des espèces et celui des individus reflète certaines conditions moyennes du milieu ; ces êtres sont liés par une dépendance réciproque. Par là, elle innove dans la description des communautés biotiques. Elles représentent, dans la série des niveaux d’organisation qui caractérisent le monde vivant, des unités structurées à l’échelle des populations, puisqu’elles regroupent des ensembles d’individus habitant à une époque donnée dans un milieu donné. Dans un tel système, deux faits essentiels caractérisent l’agencement des espèces : la distribution spatiale (ordonnance caractéristique) et temporelle (obéissant à une séquence de stades ou phénophases). (d’après 331)
Bio-indicateurs : ce sont des organismes vivants (population) ou des groupes d’organismes (peuplement ou communauté) qui peuvent fournir des informations sur la « qualité » de l’environnement dans lequel ils se trouvent. Ils sont souvent utilisés pour évaluer la « santé » des écosystèmes, car leur présence, leur abondance, peuvent refléter les conditions environnementales (facteurs écologiques), comme la pollution (ou plus récemment et d’actualité, les changements climatiques). En exploitant ces indicateurs, les écologues peuvent mieux comprendre l’impact des activités humaines sur la nature et prendre des mesures pour protéger l’environnement (cours professé d’écologie systématique – FRONTIER S. – PICHOD-VIALE D. & al.)
Biotope : aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions écologiques particulières (sol, climats, etc.) servant de support physique aux organismes qui constituent la biocénose 263. N.B. : l’écosystème est constitué par l’ensemble, biotope (+) biocénose 942.
Chorologie : science qui a pour objet l’étude de la répartition géographique des organismes vivants 263.
Communauté : syn. de biocénose (Community) 263, 466, 675. Cela reste cependant discutable.
CORINE Biotopes : publiée officiellement en 1991 pour les 12 pays de l’Union européenne, la typologie CORINE Biotopes a été élaborée par le Conseil de l’Europe dans le but de produire un standard européen de description hiérarchisée des milieux naturels. La classification est essentiellement fondée sur la nomenclature phytosociologique mais intègre des notions d’espèces dominantes et de géomorphologie. Actuellement, le catalogue CORINE Biotopes est le seul référentiel validé en Europe. Dans la pratique, la typologie CORINE Biotopes s’avère parfois peu opérationnelle : c’est tout d’abord un référentiel européen qui ne peut pas tenir compte de toutes les particularités nationales, voire régionales. Il est souvent difficile de rattacher un groupement végétal identifié sur le terrain à un code CORINE. Par ces difficultés, l’interprétation du catalogue CORINE peut varier selon les utilisateurs. Voir EUNIS.
Directive « Habitats » : Directive 92-43 / CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels (Natura 2000) abritant les habitats naturels et les habitats d’espèces de faunes et de flore sauvages d’intérêt communautaire. Elle comprend une annexe I (habitats naturels), une annexe II (espèces animales et végétales) et une annexe III relative aux critères de sélection des sites (source : ministère de l’Environnement).
Directive européenne : texte adopté par les États membres de l’Union européenne prévoyant une obligation de résultat au regard des objectifs à atteindre, tout en laissant à chaque État le choix des moyens, notamment juridiques, pour y parvenir. Chaque État doit rendre son droit national conforme à une directive européenne (source : ministère de l’Environnement).
Espèces d’intérêt communautaire : espèces en danger ou vulnérables ou rares ou endémiques (c’est-à-dire propres à un territoire bien délimité) énumérées à l’annexe II de la directive et pour lesquelles doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) (source : ministère de l’Environnement).
EUNIS : la classification européenne EUNIS est censé remplacer la classification CORINE Biotopes. Elle a été développée afin d’harmoniser la description et l’inventaire des données sur les habitats en Europe. Il s’agit d’un système hiérarchique à trois niveaux. Base V2 sur http://eunis.eea.europa.eu/index.jsp
Facteur écologique : élément du milieu, de nature physique, chimique (Abiotique) ou biologique (Biotique), susceptible d’agir directement sur la répartition des organismes vivants, leur comportement et leur métabolisme 263. Plus précisément, les facteurs abiotiques sont représentés par les phénomènes physicochimiques (lumière, température, humidité de l’air, composition chimique de l’eau, pression atmosphérique et hydrostatique, structure physique et chimique du substrat) et les facteurs biotiques sont déterminés par la présence, à côté d’un organisme, d’organisme de la même espèce ou d’espèces différentes, qui exercent sur lui une concurrence, une compétition, une prédation, un parasitisme, et en subissent à leur tour l’influence 331.
Gestion : Actions visant, dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d’harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales.
Habitat : milieu, biotope, dans lequel vit une espèce donnée ; c’est son environnement particulier, immédiat. Chaque végétal affectionne plutôt tel habitat que tel autre, à cause des particularités locales, des facteurs écologiques du milieu qu’il y rencontre et qui répondent à ses exigences. Syn. : Oikos 263, 1229
Habitats d’intérêt communautaire : Habitat énuméré à l’annexe I de la directive et pour lesquels doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C). (source : ministère de l’Environnement) et correspondant généralement à des habitats en danger ou ayant une aire de répartition réduite ou constituant des exemples remarquables de caractéristiques propres à une ou plusieurs des six régions biogéographiques.
Milieu : l’organisme et son milieu constituent le binôme fondamental de l’écologie. Si on limite l’étude pratique du milieu à celle de l’environnement, on peut essayer de le définir comme l’ensemble des facteurs abiotiques et biotiques (= facteurs écologiques) qui régissent l’existence d’un organisme, animal ou végétal et d’une biocénose. Précisons qu’il y a des facteurs simples (lumière, température…) et des facteurs complexes (nature du sol) agissant les uns et les autres directement ou indirectement. Notons, qu’il est impropre de considérer ce terme comme synonyme de celui d’écosystème, c’est-à-dire comme synonyme d’un concept qui devrait comprendre, non les facteurs du milieu exclusivement, mais la résultante de ceux-ci et les peuplements qu’ils conditionnent (d’après 263,331,1054).
Milieu naturel : terme désignant des milieux (= biotopes) assez peu transformés par l’homme. Exemples : forêts d’arbres non plantés, falaises littorales ; voir étangs, marais.
Milieu semi-naturel : terme désignant des milieux (= biotopes) qui ont été transformés par l’homme et où l’action humaine est constante pour empêcher les phénomènes de succession de se produire. Exemples : pelouses, prairies »
Mimétisme batésien : le mimétisme batésien est une forme de mimétisme où une espèce inoffensive (le mime) a évolué pour ressembler à une espèce dangereuse ou désagréable (le modèle). Cette ressemblance trompe les prédateurs potentiels (le dupe), qui associent l’apparence du modèle à une expérience négative (comme une piqûre, un mauvais goût ou une toxicité) et évitent ainsi le mime inoffensif. Le nom de ce phénomène vient du naturaliste anglais Henry Walter Bates, qui l’a décrit pour la première fois au 19ᵉ siècle en étudiant les papillons d’Amazonie. Les Syrphidae et le Mimétisme Batésien : Les Syrphidae sont un excellent exemple d’insectes pratiquant le mimétisme batésien. De nombreuses espèces de Syrphidae ont développé une ressemblance frappante avec des hyménoptères tels que les Vespidae, les Apoidea et les Bombus spp.. Comment se manifeste ce mimétisme chez les Syrphidae ?
- Coloration : Beaucoup de Syrphidae présentent des motifs de couleurs comparables à ceux des Vespidae ou des Apoidea, avec des bandes alternées de jaune, de noir ou d’orange sur leur abdomen.
- Forme du corps : certaines espèces ont un corps qui imite la forme plus trapue et poilue des Apoidea ou des Bombus spp. ou la silhouette plus élancée des Vespidae.
- Comportement : Leur vol rapide et bourdonnant peut également renforcer la ressemblance avec les hyménoptères.
- Mimétisme des antennes : bien que leurs antennes soient fondamentalement différentes (courtes avec une arista), certains Syrphidae peuvent les agiter d’une manière qui rappelle quelque peu les antennes plus longues des Vespidae ou des Apoidea.
- Pourquoi les Syrphidae pratiquent-elles le mimétisme batésien ? Contrairement aux Vespidae et aux Apoidea, les Syrphidae sont inoffensifs. Elles ne possèdent pas de dard et ne peuvent pas piquer. En imitant l’apparence d’insectes craints par de nombreux prédateurs (oiseaux, lézards, araignées, etc.), les Syrphidae bénéficient d’une protection contre la prédation. Les prédateurs, ayant appris à éviter les insectes piqueurs, sont moins susceptibles d’attaquer un Syrphidae qui leur ressemble.
- Exemples de Syrphidae mimétiques :
- Eristalis tenax : ressemble très fortement à une Apoidea domestique.
- Helophilus pendulus : imite l’apparence d’une Vespidae avec ses bandes jaunes et noires.
- Volucella spp. : certaines espèces de ce genre imitent l’apparence de Bombus spp., étant grandes et poilues avec des couleurs similaires.Episyrphus balteatus : bien que moins
- Un imitateur parfait, ses bandes jaunes et noires rappellent celles de certaines Vespidae.
Ainsi, le mimétisme batésien est une stratégie de survie efficace pour les Syrphidae, leur permettant d’échapper aux prédateurs en se faisant passer pour des insectes dangereux (ou désagréables). C’est un exemple flagrant de la sélection naturelle, dans l’évolution de l’habitus (= apparence) et du comportement des organismes (d’après 43, 44).
Niche écologique : concept fondamental en écologie qui décrit le rôle et la position d’une espèce dans son environnement. Elle englobe tous les aspects de la vie d’une espèce, y compris :
- Son habitat : l’endroit physique où l’espèce vit.
- Ses ressources : ce qu’elle mange, comment elle s’alimente, les ressources dont elle a besoin pour se reproduire, etc.
- Ses interactions avec d’autres espèces : ses prédateurs, ses proies, ses compétiteurs, ses parasites, ses mutualistes, etc.
- Son rôle fonctionnel dans l’écosystème : Comment elle contribue au flux d’énergie et au cycle des nutriments (= matières).
- Les conditions environnementales dont elle a besoin (physiographie, etc.) : La température, l’humidité, le pH, etc.
En d’autres termes, la niche écologique est la « profession » (ou le « mode de vie ») d’une espèce dans son écosystème, tandis que l’habitat est son « adresse ».
Exemples de niches écologiques :
- L’écureuil : sa niche écologique est celle d’un mammifère arboricole qui se nourrit principalement de noisettes et d’autres graines. Son habitat est la forêt.
- Le pic épeiche : sa niche écologique est celle d’un oiseau qui se nourrit d’insectes xylophages qu’il extrait des troncs d’arbres à l’aide de son bec puissant. Son habitat est la forêt et les zones boisées.
- Le trèfle (Trifolium spp.) : sa niche écologique est celle d’une plante herbacée qui fixe l’azote de l’air grâce à des bactéries symbiotiques présentes dans ses racines. Son habitat peut être les prairies, les pelouses, etc.
- Un champignon décomposeur : sa niche écologique est de décomposer la matière organique morte (feuilles, bois mort, etc.), contribuant ainsi au recyclage des nutriments dans l’écosystème. Son habitat est varié, en fonction du type de matière organique qu’il décompose.
Différence entre niche écologique et habitat (voir définition) :
L’habitat est l’endroit où un organisme vit. Il s’agit d’un lieu physique caractérisé par certaines conditions environnementales.
La niche écologique est un concept plus large qui inclut non seulement l’habitat, mais également le rôle fonctionnel de l’organisme dans cet habitat, ses interactions avec les autres espèces et son utilisation des ressources.
Deux espèces peuvent partager le même habitat, mais elles ne peuvent pas occuper exactement la même niche écologique pendant une longue période. La compétition pour les ressources entraînerait l’exclusion compétitive d’une des espèces ou une spécialisation de leurs niches pour éviter la compétition directe.
Par conséquent, la niche écologique est une description multidimensionnelle de la façon dont un organisme vit et interagit avec son environnement, tandis que l’habitat est simplement le lieu où il se trouve 263,331,942,1054,1229.
Nomenclature binomiale : système d’identification des espèces dans lequel chacune de celles-ci est désignée par un double nom latin. Le premier précise le genre et le second l’espèce 261,263.
Paléarctique occidental : le paléarctique occidental couvre la partie occidentale de l’empire paléarctique, à savoir l’Europe, l’Afrique du Nord, jusqu’au Sahara central (Hoggar et Tibesti inclus), et le Moyen-Orient, ainsi que les Açores, Madère, les Canaries, les îles du banc d’Arguin (Mauritanie) et les îles du Cap-Vert. Il est séparé du Paléarctique oriental par l’Oural, la Caspienne, la frontière occidentale de l’Iran, et exclut la plus grande partie de la péninsule arabique.
Réseau Natura 2000 : Réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de Protection Spéciales et les Zones Spéciales de Conservation. Dans les zones de ce réseau, les États Membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d’habitats et d’espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles (source : ministère de l’Environnement).
La constitution du réseau Natura 2000 concourt à de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable. Le réseau Natura 2000 est régi par deux directives européennes déclinées en droit français qui entrainent la création de deux zonages différents :
La Zone de Protection Spéciale La directive « Oiseaux » de 1979 concerne la conservation des oiseaux sauvages. Les annexes de cette Directive désignent notamment les espèces d’oiseaux les plus menacées de la Communauté européenne devant faire l’objet de mesures de conservation spéciales concernant leur habitat. La mise en œuvre de cette Directive se fait par la mise en place de Zones de Protection Spéciales (ZPS), ces zones étant directement issues des anciennes ZICO.
La Zone Spéciale de Conservation La directive « Habitats-Faune-Flore » de 1992 contribue à la conservation d’habitats naturels ou semi-naturels à forte valeur écologique, rares et/ou menacés, ainsi que d’espèces de faunes et de flore menacées et/ou dont le rôle dans l’écosystème est primordial.
Restauration : intervention dans un milieu pour y rétablir un écosystème (ou une espèce) considéré comme indigène et historique. Il suffit d’arrêter ou contrôler les actions humaines sur ce milieu (par un entretien adapté). Il faut pour se faire que l’écosystème soit encore sur sa trajectoire d’évolution normale et puisse avoir encore la faculté de réagir positivement (on appelle cette dernière fonction : « la résilience »). Certains parlent dans ce cas de « restauration passive » par opposition à la « restauration active », plus couramment appelée « réhabilitation (D’après D. Feuillas) et 1483.
Site : le critère de définition d’un site, paraît être, d’une part, une certaine homogénéité géomorphologique et d’autre part, un isolement géographique, c’est-à-dire une absence de continuité spatiale de végétation (absence de connectivité) avec un autre site de même géomorphologie. (d’après 187). Cependant, dans le cadre d’étude « sitologique », la notion de site est plus pragmatique et liée à une propriété.
Station : étendue de terrain de superficie variable, homogène dans ses conditions physiques et biologiques et qui est caractérisé par une végétation uniforme. Dans une station donnée, il existe ordinairement plusieurs individus d’association. (d’après 331, 358) Rq. : ne pas confondre avec la notion de station forestière qui est — avant toute chose — un outil de diagnostic précis et finalisé vers la gestion forestière 181. Cependant, la notion la plus admise, au moins chez les botanistes français, est celle du secrétariat Faune et Flore du Muséum National d’Histoire Naturelle. Cet organisme considère comme une station tout lieu où se localise un effectif plus ou moins grand d’individus d’un taxon étudié, effectif spatialement isolé d’au moins une cinquantaine de mètres d’un autre effectif du même taxon. Cette notion est équivalente à celle de sous-population, c’est-à-dire de groupe distinct d’individus de même taxon, mais ne présentant pas d’échange génétique (d’après 187, 1018).
Sténohèce : se dit d’une espèce incapable de peupler des milieux caractérisés par des variations plus ou moins accentuées des facteurs écologiques 263.
Synécologie : étude écologique combinée des exigences globales de l’ensemble des acteurs d’une biocénose. C’est donc une approche synthétique de la communauté active avec toutes les interactions liées 6,37. Syn. De biocénotique : qui a pour objet l’étude des biocénoses 263.
Traits fonctionnels : en écologie, ce sont des caractéristiques mesurables d’un organisme (morphologiques, physiologiques, phénologiques) qui influencent sa performance (survie, croissance, reproduction) et son effet sur l’écosystème (cycles biogéochimiques, flux d’énergie, interactions avec d’autres espèces).
En d’autres termes, les traits fonctionnels permettent de comprendre comment les organismes vivent, interagissent entre eux et avec leur environnement, et quel rôle ils jouent dans le fonctionnement des écosystèmes.
Voici quelques exemples de traits fonctionnels : - Pour les Plantae :
- Taille des feuilles,
- Type de photosynthèse,
- Hauteur maximale (plutôt hauteur moyenne végétative – GLB),
- Type de dispersion des graines (Chorie),
- Concentration en azote des feuilles,
- Densité du bois,
- Architecture racinaire.
- Pour les animaux :
- Régime alimentaire,
- Taille corporelle,
- Mode de locomotion,
- Cycle de vie,
- Comportement de reproduction,
- Taille du territoire.
L’étude des traits fonctionnels est importante en écologie pour plusieurs raisons :
- Comprendre les réponses des espèces aux changements environnementaux : les traits fonctionnels peuvent aider à prédire comment les espèces réagiront aux changements climatiques, aux perturbations ou aux invasions biologiques.
- Analyser le fonctionnement des écosystèmes : En étudiant les traits des espèces présentes, on peut mieux comprendre les processus clés comme la production primaire, la décomposition, le cycle des nutriments et les interactions trophiques.
- Évaluer la biodiversité : la diversité fonctionnelle, qui analyse la variété des traits présents dans un écosystème, est un indicateur important de la santé et de la résilience des écosystèmes. Elle achève les mesures classiques de diversité spécifique (nombre d’espèces).
- Améliorer la gestion des écosystèmes : La connaissance des traits fonctionnels peut aider à orienter les pratiques de conservation et de restauration écologique en favorisant les espèces qui remplissent des fonctions majeures.
L’écologie fonctionnelle est le domaine de l’écologie qui se concentre sur le rôle des traits fonctionnels dans les communautés et les écosystèmes. Elle vise à comprendre comment la diversité des traits influence les processus écologiques et les services écosystémiques.
Ainsi, les traits fonctionnels sont des outils essentiels pour comprendre la complexité du vivant et son rôle dans le fonctionnement de la biosphère. Ils permettent de dépasser la simple description des espèces pour analyser les mécanismes sous-jacents aux dynamiques écologiques (d’après 1482, 1483 et 1522).
Valeur patrimoniale : valeur attribuée à des milieux, espèces ou ressources naturelles qui présentent un intérêt tel qu’ils doivent être conservés et transmis aux générations futures, qui appartiennent à l’héritage collectif.
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : sites désignés par les États membres de l’Union européenne au titre de la directive 92-43 / CEE dite directive « Habitats » (source : ministère de l’Environnement).
Annexes
Syrph the Net (StN) :
Il s’agit d’un « système expert » développé dans un but scientifique :
- Les bio-indicateurs : StN utilise les Syrphidae comme indicateurs écologiques ou « bio-indicateurs ». Ces « bio-indicateurs » sont des espèces ou des groupes d’espèces qui peuvent être utilisés pour évaluer l’état de conservation (sa santé et la qualité) de l’environnement.
- La conservation des habitats : le système expert est spécialement conçu pour normaliser l’utilisation des Syrphidae afin d’évaluer l’état de conservation des habitats semi-naturels. Cela signifie qu’il fournit un moyen structuré et cohérent d’utiliser les données sur les Syrphidae pour comprendre dans quelle mesure ces habitats sont préservés.
- La normalisation : l’objectif principal de « StN » est de normaliser le processus d’utilisation des Syrphidae pour ce type d’évaluation environnementale. Cela implique des protocoles définis pour la collecte des données, l’identification des espèces et l’analyse afin de garantir des résultats cohérents et comparables.
En conclusion, Syrph the Net (StN) est un outil scientifique, un système expert, axé sur l’utilisation des Syrphidae comme indicateur écologique (« bio-indicateurs ») pour évaluer l’état de conservation des habitats semi-naturels, voir naturels.
Sources Web :
- fr.wikipedia.org
Photographie
- João P. BURINI_Travail personnel_Matutu valley, Aiuruoca, Brazil CC BY-NC-ND 4.0
Sources bibliographiques :
- BÄCHLI G. & MERZ B., Diptera of Switzerland : Syrphidae. Volume 2 – 2000
- BALL S. & MORRIS R., Britain’s Hoverflies : A Field Guide to the Hoverflies of Great Britain and Ireland – 2024
- BOT F. & (DE) MEUTTER F. V., Hoverflies of Britain and North-West Europe : A photographic guide – 2023
- BRUCCIAMACHIE M., Protocole de suivi d’Espaces Naturels protégés, Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable – 2005
- CASTELLA, E. & SPEIGHT M.C.D., Knowledge representation using fuzzy coded variables : an example based on the use of Syrphidae (Insecta, Diptera) in the assessment of riverine wetlands, Ecological Modelling – 1996
- CASTELLA, E., SPEIGHT M.C.D. & SARTHOU J-P., L’envol des syrphes, Espaces Naturels – 2008
- CAVAILLES, S. et DUSSAIX, C., Application de la méthode Syrph the Net aux habitats de la réserve naturelle régionale « Coteau et prairies des Caforts » (72). Rapport pour le Conservatoire d’Espaces Naturels Pays de la Loire – 2019
- CHINERY M., Insectes de France et d’Europe occidentale, Arthaud – 1988
- CHINERY M., Insectes d’Europe, Bordas – 1992
- CLAUDE J., TISSOT B., MAZUEZ C., VIONNET G., SARTHOU J.P. & CHANAL F., Diagnostic écologique des principaux habitats de la Réserve Naturelle Nationale du lac de Remoray (25) par la méthode ‘‘Syrph the Net’’, Les amis de la réserve naturelle du lac de Remoray – 2012
- DUREPAIRE P., Diagnostic écologique des habitats dans la Réserve Naturelle de la Tourbière des Dauges (Haute-Vienne) par la méthode « Syrph the Net » – 2018
- DUSSAIX C., Syrphes de la Sarthe – Éthologie, écologie, répartition et développement larvaire (Diptera, Syrphidae). Invertébrés armoricains, les Cahiers du GRETIA – 2013
- FIERS V., Guide pratique : Principales méthodes d’inventaire et de suivi de la biodiversité, RNF – 2004
- FRONTIER S., PICHOD-VIALE D., LEPRETRE A., Dominique DAVOULTD D., LUCZAK C., Ecosystèmes – Structure, Fonctionnement, Évolution, Dunod – 2008
- ROTHERAY, G. E. & Gilbert, F., The Natural History of Hoverflies. Insect Conservation and Diversity – 2011
- SARTHOU J.P., Contribution à l’étude systématique, biogéographique et agroécocénotique des syrphidae (insecta, diptera) du sud-ouest de la France, Thèses de doctorat, Institut national polytechnique de Toulouse – 1996
- SARTHOU J-P. & SPEIGHT M.C.D., Les diptères Syrphidae, peuple de tous les espaces, Insectes – 2005
- SARTHOU J.-P., SARTHOU V. & SPEIGHT M. C.D – Clé des 88 genres de Diptères Microdontidae et Syrphidae d’Europe occidentale – 2021
- SKEVINGTON J. H. & al., Field Guide to the Syrphidae of Canada – 2019
- SPEIGHT M.C.D., Les invertébrés saproxyliques et leur protection, Conseil de l’Europe, collection Sauvegarde de la Nature – 1989.
- SPEIGHT M.C.D., Identification of priorities in conservation of European saproxylic syrphids (Diptera : Syrphidae), in International Symposium on the Syrphidae II, Biodiversity and Conservation 16-19th June 2003 – 2003
- SPEIGHT M.C.D., Species accounts of European Syrphidae (Diptera). Syrph the Net, the database of European Syrphidae, Syrph the Net publications – 2012
- SPEIGHT M.C.D. & GOOD J.A., Development of eco-friendly forestry practices in Europe and the maintenance of saproxylic biodiversity in MASSON F., NARDI G., & TISATO M. – 2003.
- SPEIGHT M.C.D., CASTELLA E. & OBRDLIK P., Use of the Syrph the Net database – 2000
- STUBBS A. E. & FALK S. J., British Hoverflies: An Illustrated Identification Guide. British Entomological and Natural History Society – 2002
Licence Creative Commons : CC BY-NC-ND 4.0 - Pas d’utilisation commerciale / Pas de modification.